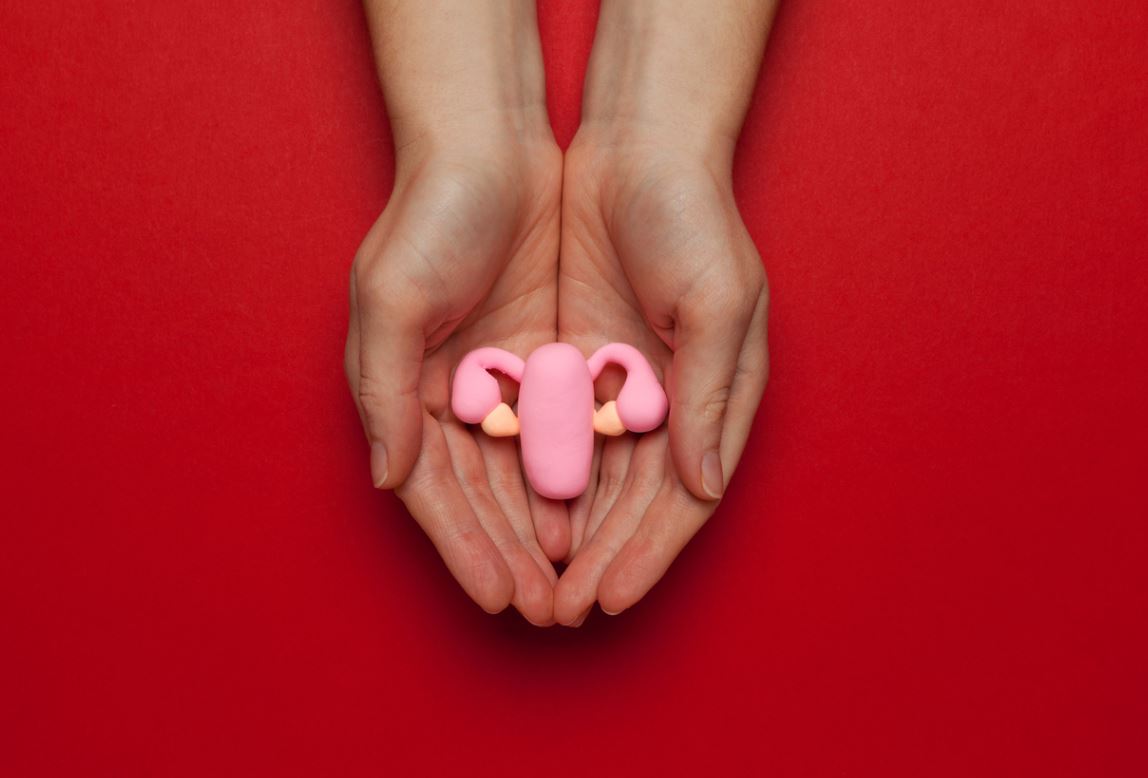L’endométriose : qu’est-ce que c’est ?
L’endomètre est la muqueuse qui recouvre l'intérieur de l'utérus. Sa structure évolue au cours du cycle elle s'épaissit progressivement après l'ovulation, sous l'action des hormones. A la fin de chaque cycle, cette muqueuse se décolle des parois de l'utérus et s'évacue : ce sont les règles.
L'endométriose se définit par la présence de cette muqueuse qui se développe en dehors de l'utérus, le plus souvent sur les ovaires ou le péritoine, la membrane qui entoure les viscères de l'abdomen. Les tissus touchés vont évoluer de la même manière qu'à l'intérieur de l'utérus et saigner à chaque période de règles. Puisque le sang ne peut pas être évacué, il va rester bloqué et former des petites poches de sang : des kystes hématiques.
Le développement de cette muqueuse sur d'autres organes que l'utérus provoque également des lésions. Elles peuvent être plus ou moins graves, en fonction de leur emplacement.
À lire également : Règles douloureuses : les plantes qui soulagent
Des causes encore inconnues
Les causes de l'endométriose sont encore mal connues, et les symptômes, difficiles à supporter : des règles douloureuses et abondantes, des douleurs pendant les rapports sexuels, une infertilité inexpliquée, des douleurs pelviennes chroniques, une grande fatigue, ou des troubles gastro-intestinaux.
Ces symptômes augmentent pendant les règles. Si celles-ci sont trop douloureuses, il est nécessaire de consulter. La diversité des signes est telle que le diagnostic est posé très tardivement.
Beaucoup de femmes dans ont été diagnostiquées six à dix ans après l'apparition de la maladie. A cause des douleurs chroniques, la plupart des patientes voient leur qualité de vie altérée, tant professionnellement qu'affectivement. Surtout que la majorité d'entre elles n'arrive pas à mettre un nom sur leurs souffrances.
Attention, les souffrances ne sont pas proportionnelles à l'étendue des lésions. II faut consulter dès que vous ressentez une douleur anormale. Les conséquences peuvent être sérieuses : en fonction de sa localisation, l'endométriose peut engendrer une infertilité.

Comment se soigner ?
Un simple examen gynécologique peut parfois suffire à détecter l'endométriose. Mais pour plus de certitude, des examens complémentaires, comme l'échographie, sont utiles. Reste que seule la cœlioscopie assure un diagnostic précis de la maladie.
Cette technique nécessite une courte hospitalisation et consiste, via une petite caméra introduite dans l'abdomen, à visualiser et à prélever d’éventuelles lésions en vue d'analyse, un autre examen l'IRM, n'est justifié qu'en cas d'endométriose sévère ou de récidive.
Ces examens sont d'autant plus efficaces qu'ils sont réalisés à un moment du cycle proche de la période des règles.
Des traitements hormonaux et chirurgicaux
Le traitement hormonal consiste à bloquer le fonctionnement de l'ovaire, ce qui stoppe les règles. Cette "ménopause artificielle" arrête l'évolution de l'endométriose, qui parfois régresse. Ces médicaments se présentent sous deux formes : les progestatifs et les analogues de la Gn-Rh. Bien qu'ils puissent provoquer des effets secondaires comme des bouffées de chaleur, ils soulagent presque toujours la douleur.
Attention, pendant la durée du traitement (au moins un an), le fonctionnement de l'ovaire est suspendu ; ce qui empêche toute grossesse. Enfin, à l'arrêt de ce traitement hormonal, les douleurs risquent de revenir.
L'opération permet de retirer toutes les lésions d'endométriose sur les tissus touchés. Souvent indiquée en cas de kystes, de douleurs récalcitrantes et d'infertilité, elle s'effectue sous cœlioscopie. Le chirurgien visualise les zones touchées par l'endométriose et peut en même temps essayer de "réparer" les régions atteintes (enlever les adhérences), pour permettre de retrouver une fertilité normale.
Dans les cas plus sévères et rares (5 %), une intervention plus importante est pratiquée, nécessitant une petite incision au niveau de l'abdomen. Avec ces opérations conservatrices (qui ne nécessitent pas d'enlever l'utérus), de nombreuses femmes peuvent parvenir à être enceintes. Sinon, le recours à la Procréation médicale assistée (PMA) peut faciliter la grossesse. Malheureusement, après l'intervention, les risques de récidives existent, même s'ils sont rares. Ils peuvent ne pas excéder 10 % à 15 % des cas. De plus, le délai des récidives peut être retardé avec un traitement hormonal postopératoire.
Enfin, pour venir à bout de la douleur dans les cas très sévères, une hystérectomie (ablation de l'utérus) peut être nécessaire, mais elle entraîne une infertilité. Sachez aussi que les douleurs disparaissent temporairement avec la grossesse et définitivement avec la ménopause.
À lire aussi :